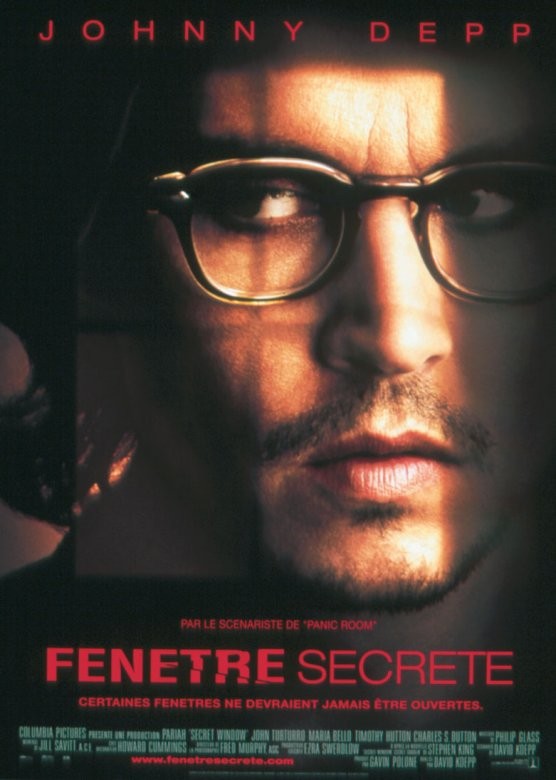Fin XVIIIe siècle
Un homme met le pied dans Charlevoix. Il s’appelle John Otis et arrive de la Nouvelle-Angleterre, où il a été élevé chez les Abénakis. Il a les oreilles coupées. L’histoire ne dit pas pourquoi cette mutilation. Peut-être une manière de dire : « Tu es à nous maintenant ». Sa mère s’appelait Anna Shuah et appartenait à la nation alliée des Français qui a rasé, à leur demande, en pleine guerre de Sept Ans, le village où habitait John avec sa petite soeur et ses parents. Tous les adultes ont été tués. Mais pas les enfants. Les enfants étaient et sont toujours sacrés pour les gens des Premières Nations. Aussi le petit John et sa soeur ont été adoptés, comme c’était la coutume, par ce peuple dont ils étaient déjà à moitié issus.
Donc John se pointe dans Charlevoix, on ne sait pas trop pourquoi, où il se fera connaître comme étant Jean Otis dit l’Anglais. Il épouse une femme. Certaines sources la disent Montagnaise, d’autres métisses, d’autres, rien. Dur de remonter la lignée des femmes. Ce couple est l’ancêtre de tous les Otis du Québec. Dont ma mère. Sa descendance va s’installer de l’autre côté du fleuve, dans le coin de Matane. C’est là que, presque un siècle et demi plus tard, Joseph Otis, mon arrière-grand-père maternel, rencontrera Clémentine, une Micmaque, à la mission Matane où campaient à l’époque pas mal d’Indiens, semble-t-il. Ils s’aimeront. Ils s’épouseront.
La toute jeune Loi sur les Indiens stipule que Clémentine doive maintenant couper tout contact avec son peuple. Histoire de bien blanchir les enfants du couple. Ainsi mon grand-père Zénon, leur fils, comme tous leurs autres enfants, ne connaîtra pas ses grands-parents, ses oncles et tantes, ses cousins-cousines, les histoires, les chansons, la langue. Il ne pourra rien transmettre de tout cela à ses enfants, à ma mère, qui ne pourra rien me transmettre non plus. J’ai su que j’étais métisse bien tard dans ma vie. Je suis comme tous les descendants de ces femmes à qui l’on a coupé la mémoire, le fil de cette transmission qui nous confère notre humanité.
Puis quand j’y pense, je réalise que si ce fil n’avait pas été coupé de cette manière, si Clémentine avait pu transmettre son statut à sa descendance, j’ai l’âge d’avoir été au pensionnat. Ceux de la Gaspésie allaient en Nouvelle-Écosse, à Shubenacadie. L’un des pires. Ainsi la Loi s’assurait que le fil de l’identité, surtout transmis par les femmes — ne dit-on pas: langue maternelle? —, soit coupé d’une manière ou d’une autre. Le nom micmac de Shubenacadie signifie: bel endroit…
2017
Je n’ai pas tout cueilli. Il faut en laisser pour permettre à la Terre de continuer d’enfanter. On pince doucement le pied, cela vient tout seul, avec son parfum vert épicé d’humus. Ensuite on secoue le sac, pour qu’elles se nettoient un peu entre elles puis, à la maison, on les dépouille une à une du mince voile brun qui les habille, avant de les rincer à grande eau, une fois, deux fois. Enfin on les recouvre d’eau froide, on sale un peu et on les fait blanchir, dix minutes. Après c’est comme on veut. On congèle, on canne, on les saute au beurre. Manne de mai, les têtes de violon se vendent à prix d’or à l’épicerie du coin, et valent tous les efforts qu’on met à les cueillir et les préparer.
Je pense à mon arrière-grand-mère Clémentine, la micmaque. Dans la vallée de la Matapédia, où elle a élevé sa famille, les fougères abondent. Sans doute a-t-elle fait cette cueillette elle aussi, à cette époque où l’on devait compter sur la nature pour compléter ce que le travail du bois et des champs ne fournissait pas en suffisance. Je la vois penchée sous les feuillages odorants, les jupes relevées pour plus de commodité, un fichu sur ses cheveux noirs, sa peau brune couverte d’une légère sueur, chassant de temps à autre les mouches noires revenues à la vie après le long hiver. Est-ce que mon grand-père Zénon l’accompagnait dans ses promenades nécessaires? Le portait-elle dans un tikinakan comme ses ancêtres l’avaient fait avec leurs propres bébés? Faisait-elles des conserves, des pots bouillant longuement sur le grand poêle à bois? Je la vois grande et osseuse, comme mon grand-père son fils, mon grand-père métis que je n’ai connu que sur des photos où il pose debout au milieu de ses hommes, sur un chantier de bûcherons dont il était le contremaître, l’oeil noir vif, les pommettes hautes, les traits bien découpés, le cheveu de jais, tous traits dont ma mère avait hérités et dont je garde quelques traces brouillées par les autres sangs, irlandais, normand, écossais, qui coulent dans mes veines. De quoi ai-je hérité aussi de cette femme?
Ces gestes plusieurs fois millénaires qui n’existent que dans cette partie-ci du monde: cueillir et préparer les têtes de violons. Ce n’est certes pas dans mon enfance que je les ai appris, mes adultes étaient trop occupés à autre chose. Ce besoin d’accueillir dans mes mains et dans ma maison les fruits offerts par la Terre à ses enfants. Je n’ai pas grandi dans une famille où l’on cueillait quoi que ce soit. Ni les fougères, ni les fraises sauvages, ni les noisettes. Pourtant je me souviens de moi enfant, accroupie dans le sous-bois cueillant de petites mûres sauvages, celles qu’on nomme catherinettes, je me revois à quatre pattes dans le clos en quête de fraises, debout le long des clôtures les doigts prudents parmi les framboisiers bourdonnants d’abeilles. Petite, intéressée déjà par les vertus des plantes des forêts, je lisais tout ce qui me tombait sous la main et collectionnais thé des bois et du Labrador. D’où cela me vient-il?
Y a-t-il une mémoire du sang? Se peut-il que reste le souvenir, quelque part sous ma peau, de ce que mes ancêtres rouges ont enseigné à mes ancêtres blancs? Et cette Anna Shuah, la première, l’Abénakise, ancêtre de tous les Otis du Québec, de qui je descends aussi par ma mère, m’a-t-elle légué cet amour fou que je porte aux arbres? D’où me vient ce ferme sentiment d’appartenir à la Terre, d’être indissociable d’elle? À chaque retour du beau temps je retrouve le rythme de la cueillette comme un retour à la vérité du vivant. Le temps des têtes de violon est court. Je surveille les bourgeons d’épinette: ils seront prêts bientôt et feront durant l’hiver de bonnes tisanes contre le rhume.
1977
Des fois, le dimanche, avec mon père, on fait des tours de char, puis on va virer sur la réserve. Je ne regarde pas le paysage, pourtant si beau à l’embouchure de la rivière Cascapédia. Je garde les yeux rivés sur l’intérieur. Sur le bord du chemin de terre — l’asphalte finit où commence la réserve — s’alignent des bicoques peinturlurées de couleurs bâtardes, plantées sur des terrains pelés, jonchés de vieux bicycles, de pneus et de balançoires de guingois. Le tout est peuplé de myriades d’enfants bruns, cheveux de jais couettés, vieux linge aux couleurs désassorties, tous apparemment en bas de six ans, qui regardent passer notre Beaumont comme un ovni. Hormis les enfants, il y a peu de monde dehors. Les rares adultes que nous croisons ne nous regardent pas, eux. Ils regardent par terre. Parfois, ils crachent aussi, en regardant par terre. On passe, comme si on traversait un quelconque Parc Safari, mais sans garrocher de pinottes aux singes. On sent une espèce de tension, un danger dans l’air, vous comprenez ça boit fort ce monde-là, ça peut devenir violent, il y a toutes sortes d’histoires, faut jamais jamais leur tourner le dos en tout cas. Les rares commentaires proférés par mon taciturne paternel concernent le manque d’entretien des maisons données gratisses par le gouvernement à du monde qui paye même pas de taxes , ou encore il cherche à me faire admirer l’église en forme d’immense tipi, curiosité architecturale courue par les touristes. Jamais nous ne descendons de voiture. Jamais nous ne faisons un geste, n’échangeons un regard.
* * *
Quand on a de la visite l’été, il arrive qu’on les emmène au magasin d’artisanat Indian Handicraft, où l’on peut se procurer, à des prix jugés prohibitifs par la visite en question, des paniers d’écorce de frêne, spécialité des aborigènes locaux, ou encore de ces petites boîtes en foin d’odeur tressé, délicates et parfumées. On y trouve aussi des poupées en plastique au teint trop brun, décorées de plumes synthétiques, des bandeaux, des arcs, des mini canots d’écorces, quelques bijoux, des mocassins. Mon arc et mon bandeau sont mes jouets favoris de tout un été. Les madames, à la caisse, nous accueillent en silence, les bras croisés, comptent nos achats sans lever les yeux et nous remercient d’un presque inaudible « Thank you. »
* * *
Le vendredi soir, c’est le bingo du club Lions. Le gros lot est de 800$. De chez nous on voit la longue file d’autos qui arrive de Maria. C’est les Indiens de la réserve qui viennent jouer au bingo. Ils achètent des tas de cartes et couvrent les tables de portent-bonheur et des cendres des nombreuses cigarettes qu’ils fument. Ils parlent en anglais, mais sont très concentrés quand même. Ils gagnent souvent parce qu’ils achètent beaucoup de cartes. Ça tanne les gars des Lions parce que ça enlève des lots pour le monde ordinaire, tu comprends, les vrais citoyens.
C’est pas du mauvais monde pourtant. Ma mère s’est même fait conseiller d’engager des femmes de la réserve pour le grand ménage. Il paraît qu’elles sont bien vaillante et respectueuses.
1981
Le père Brébeuf agonise sur la page du livre d’histoire, les yeux révulsés, un collier de haches chauffées à blanc autour du cou. À côté de moi, Simon le Micmac serre les poings. Et les dents.
— C’est pas vrai. C’est pas vrai. Je connais personne de méchant de même, dit-il. Chus pas de même. Personne est méchant de même.
J’ai envie d’être son amie.
* * *
Sylvie sort avec Simon. Tout le monde de la réserve l’appelle Blondie. Je danse un slow avec Henry et je me demande ce que je vais faire s’il essaie de m’embrasser. J’en ai un peu envie, il est très beau, ses yeux noirs me chavirent, ses mains brunes sont chaudes autour de ma taille, ses lèvres sont appétissantes, mais en même temps je ne suis pas sûre que ça me plairait. Il a les dents cariées.
* * *
Il y a une fille dans ma classe de français. Elle s’appelle Georgina et on raconte qu’elle a un enfant. Qu’elle ne sait pas qui est le père. On dit que ces filles-là font des enfants avec n’importe qui, qu’elles accouchent comme des chattes. Je voudrais lui parler mais je ne sais pas comment l’approcher. Après tout, nous n’avons rien en commun. À part le nom de famille.
* * *
Mon ancêtre paternel s’appelait André Bernard et il était le charpentier du seigneur de La Tour, le premier seigneur d’Acadie. Il avait une épouse, à qui il a fait une trâlée d’enfants. Elle s’appelait Marie. Marie Guillot. Ou Guyon. C’est selon. Cette Marie, c’est mon aïeule.
Mon ancêtre s’appelait André Bernard et il était protestant et il s’est caché chez les Micmacs lorsque les opposants catholiques de Charles de La Tour ont pris Port-Royal. Marie l’a cru mort et s’est remariée. Lui aussi s’est remarié, même s’il se savait vivant. Il a épousé une femme dont personne n’a retenu le nom et il lui a fait une trâlée d’enfants. Cette femme, c’est l’aïeule de Georgina.
* * *
Acadie c’est un mot micmac. Ça veut dire: l’endroit, le lieu, là où l’on est. Les Acadiens ont été bien inspirés de donner ce nom à leur pays.
1982
Les Indiens font des sparages. Ils veulent avoir le droit de pêcher le saumon. Ils veulent pêcher le saumon à des fins commerciales. Quelles bande de baveux. Ils barrent la 132. La police arrive, casquée, armée, confisque les bateaux, tabasse des gens. Chez nous on trouve les méthodes raides, mais quand t’as pas le choix. Qu’ils pêchent, mais qu’ils ne viennent pas empêcher les honnêtes commerçants de faire leur job.
Les Indiens ont fait assez de sparages que finalement on leur confie la gestion de la rivière. Trente ans plus tard, la ressource se portera mieux qu’elle ne s’est portée dans les 300 dernières années.
* * *
Listuguj est un mot Mi’kmaq. Ça veut dire: désobéis à ton père.
1985
Quand des amis du cégep viennent me visiter, je leur explique comment différencier les maisons des Anglais de celles des Français et de celles des Indiens. C’est facile. Les maisons des Anglais sont toutes pimpantes, les jardins bien entretenus, les fleurs impeccablement disposées, les clôtures fraîchement peintes. Les maisons des Français sont tounues, mais le gazon est bien tondu quand même. Les maisons des Indiens ont des poteaux de galerie qui manquent, elles sont peinturlurées de restes de couleurs démodées, les cours sont pleines de traîneries.
Le bar d’Escuminac est souvent fermé pour réparations. Les Indiens de Restigouche s’y saoulent et ça vire en bagarre, et puis ça brise tout. Je trouve ça drôle. Je me fais accroire que je vis dans un western et que j’impressionne ma visite avec ça.
* * *
Escuminac c’est un mot micmac. Ça veut dire: avant. Je ne sais pas si ça veut dire avant dans le temps ou avant dans l’espace. Probablement les deux
1990
La photo montre un face à face intense entre un homme casqué et un homme masqué. C’est la guerre. Michel a découpé la une du Soleil pour quand son bébé sera grand, pour lui montrer cette chose inimaginable, les soldats et les barbelés en plein coeur du Québec.
* * *
L’autobus qui me ramène en Gaspésie pour les vacances est forcé de faire un détour par le Nouveau-Brunswick, le chemin étant bloqué à la hauteur de Restigouche par un grand Micmac qui se tient debout en plein milieu, les bras croisés, tout seul. Je le trouve courageux et un peu fou.
Je ne sais rien.
2002
Au cégep où j’enseigne, il y a des étudiants Autochtones. Les accompagnant dans leur parcours, je découvre les cultures Innue, Crie, Atikamekw, et d’autres. J’apprends qu’il y a onze nations différentes chez nous, onze cultures, onze langues. Que leurs villages ne sont pas sur les cartes. Je lis un nombre incalculable de textes, dont l’inqualifiable Loi sur les Indiens. J’écoute leurs histoires. Je partage leurs rires. Je vais visiter les communautés. J’apprends des bribes de leurs langues. Je m’attache à leurs enfants. Certains deviennent des amis vrais, chers, au-delà du partage des cultures. Au fil des ans, ces personnes me transformeront plus que je ne l’aurais jamais cru possible.
Au fil des ans, le contact privilégié que j’ai pu avoir avec les gens des Premières Nations m’a aidée à devenir une meilleure humaine.
2012
À l’hôpital de Roberval, une vieille dame mourante me tend la main. Elle garde la mienne longtemps en me regardant dans les yeux, très fort. On se parle comme ça, avec les yeux. Puis elle me tapote la paume en hochant la tête, et elle ferme les paupières. Mes yeux à moi sont pleins de larmes quand je rejoins les autres à l’ascenseur. Mario, son gendre, me dit : « C’est un signe d’appréciation, ça. » C’est cette femme-là qui a fait, il y a quelques années, les mocassins que je porte encore.
Je pars avec la fille de cette femme. Elle a mon âge et paraît beaucoup plus. Elle est fatiguée d’aider sa mère à mourir. Fatiguée d’élever les enfants de ses filles trop jeunes pour quitter l’école. La vie des femmes est dure dans son monde.
Nous roulons sur la route de terre, la longue route de 165 km avec les gros camions de bois, qui mène à Opitciwan. Nous parlons de tout, de rien, de nos vies, des fois avec des mots, des fois avec le silence.
Le soir, trois petites filles avec leurs robes de pow wow dansent pour moi. Je souris. Je n’ose pas prendre de photo. Nous mangeons du foie d’orignal avec des patates pilées pour souper. C’est délicieux, très doux.
Plus tard encore, une petite fille ensommeillée, blottie contre moi sur le divan, me demande si on peut dormir ensemble. Mamo.
Le surlendemain, je marche avec Véronique dans la trail de collets qu’elle marche depuis des années, et sa mère avant elle, et la mère de sa mère, visible seulement par une petite dénivellation qui serpente dans la mousse verte. « On va faire le petit tour, a-t-elle dit, ce sera plus facile pour toi… » En s’y rendant, on a vu encore des traces d’orignal, tandis que les voix du CB nous informaient de qui était où, qui avait vu quoi. Ils rient, se taquinent. Nous traversons une coupe à blanc. Je me dis : « Je suis avec la Résistance. »
La résistance se fait dans le bois, à coups de rires d’enfants et de pose de collets. La résistance coupe des bûches, chasse, cuisine et lave la vaisselle. La résistance chante dans une langue dont on a voulu qu’elle disparaisse. La résistance est une petite fille de six ans qui écoute des chants traditionnels sur son IPod Touch.
La résistance fait danser ses enfants sur une comptine qu’on croyait oubliée. Aaaaaah ! Nim[i] tcitciw, ah ! nim[i] tcitciw, ah ! nim[i] tcitciw…
Pour souper, soupe de farine, viande fumée, filet d’orignal, banique et patates pilées. C’est moi qui fais la vaisselle. TOUTE la vaisselle, vite vite avant qu’il fasse noir. Nous n’avons ni eau courante ni électricité.
La résistance n’est pas organisée.
La résistance aime ses enfants. Mario me dit, en désignant la petite de trois ans qui ne parle toujours pas franc (elle dit popom au lieu de kokom) : « C’est pas que c’est ma préférée, celle-là, mais je pense qu’elle va avoir besoin d’un petit quelque chose de plus. »
La résistance boit du thé sur la galerie du chalet.
2015
Ma tante m’apprend l’existence de Clémentine. Quand j’annonce la nouvelle à mon amie rouge, elle me répond: « On le savait, nous autres. », avec une gentille bourrade.
2017
Je suis femme en terre d’Amérique
Et j’ai les ailes rousses
Des ailes de perdrix qui battent tambour
Mes racines aux pieds
Je danse